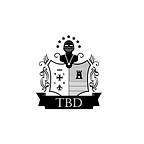La Nouvelle Pyramide de Maslow
En 1943, Abraham Maslow, psychologue américain, publie un article intitulé A Theory of Human Motivation (“Théorie de la motivation de l’être humain”) dans lequel il présente une vision novatrice de la hiérarchisation des besoins humains. Cette vision synthétique, efficace et universelle, rencontre un succès immédiat grâce à la représentation visuelle simple qui lui est associée : une pyramide à la base de laquelle nous retrouvons les besoins humains primaires, jusqu’à trouver au sommet les besoins créés par l’humain, une fois son existence assurée.
Près de quatre-vingt ans plus tard, la Pyramide de Maslow reste largement connue et enseignée. Toutefois, ces dernières années, un phénomène que le théoricien n’avait pas anticipé émerge et vient ébranler le piédestal dans lequel la Pyramide creuse ses racines depuis plus d’un demi-siècle. C’est l’enjeu de ce papier.
En effet, notre société contemporaine, bouleversée par la 3ème révolution industrielle (internet, nouveaux modes de travail et de communication) et la récente 4ème révolution (recherche de l’éradication de maladie et prolongement de la durée de vie) remet en question la simplicité du modèle Maslowien.
Comment représenter aujourd’hui de la manière la plus universelle possible les besoins d’une humanité qui n’a jamais été aussi nombreuse, connectée, complexe et pétrie d’inégalités ?
I) La Pyramide de Maslow: une vision simple et efficace du début XX siècle
La Pyramide de Maslow prend forme en 1943, aux Etats-Unis, en plein cœur de la Seconde Guerre Mondiale. A cette époque, et durant les décennies qui suivirent, la représentation proposée collait, il est vrai, parfaitement à la réalité : l’être humain, pour s’épanouir, devait d’abord répondre à ses besoins primaires et les sécuriser avant de progressivement prétendre à pouvoir grimper d’étage en étage jusqu’à arriver au sommet de la Pyramide.
En regardant en arrière vers les années 40 et les décennies qui suivirent, il est aujourd’hui chose aisée de comprendre comment les individus, bouleversés par les conflits inédits, passés ou en cours, ont pu répondre au modèle de Maslow. On imagine en effet assez bien que les décennies de (re)construction d’après-guerre furent une période propice à la (re)sécurisation des trois premiers étages de la Pyramide, tandis que les décennies qui suivirent laissèrent plus de place à l’individu pour avancer sur les suivants.
C’est évidemment en grande partie son contexte d’émergence qui peut expliquer le succès de cette théorie et le fait qu’elle reste aujourd’hui largement enseignée.
Celles et ceux d’entre nous qui ont la chance d’avoir connu ou à leurs côtés leurs grands-parents ou même leurs parents, s’ils ont plus de 70 ans, admettrons sans doute qu’il est possible de constater la prégnance de cette théorie sur la vie de nos aînés.
Après la Seconde Guerre Mondiale, le monde en ruine a dû se reconstruire et les 30 Glorieuses n’ont pas été de trop pour réparer — une partie — des dégâts. C’est durant cette époque que l’Occident a lentement mais sûrement escaladé les étages de la Pyramide.
La guerre sur le territoire national s’éloignant petit à petit, les citoyens ont pu se concentrer sur les deux derniers étages de la Pyramide: le besoin d’estime et le besoin de s’accomplir. De plus, la période était propice à ces deux besoins et offrait de multiples opportunités pour accéder à ces nouveaux paliers.
Plaçons-nous à présent à la fin des 30 Glorieuses et demandons-nous : Et après ? Qu’y a-t-il en haut de la Pyramide ?
C’est à ce moment-là que la théorie de Maslow commence à se gripper. Ou plus exactement, c’est à ce moment que la Pyramide tend à se déformer pour relier son sommet à sa base.
II) Le changement de topologie de la pyramide.
Je soumets ici l’idée qu’après les 30 Glorieuses la forme pyramidale dessinée par la théorie de Maslow n’est plus une représentation adéquate de la réalité. Je pense en effet qu’après cette période de rattrapage d’après-guerre et de semblant de paix mondial, le sommet de la pyramide s’est trouvé poussé à rejoindre sa base.
Ainsi, la pyramide ne serait plus le mot pour représenter cette théorie : cette pyramide est devenue un cercle. Pour appuyer ce nouveau paradigme nous allons regarder l’évolution du rapport au travail et de l’utilité de celui-ci à la société.
En effet, le besoin d’accomplissement dans la société pré-68 se traduit par le fait de bien gagner sa vie et au final peu importe le métier. Cependant petit à petit cette vision commence à entrer en contradiction avec notamment le besoin d’estime des autres, qui, à mesure que la société se standardise, devient de plus en plus difficile à obtenir en pratiquant le même métier que tout le monde.
C’est à partir des années 90–2000 que nous assistons aux premières générations vierges de conflits armés connaissant, certes, des inégalités de revenus, mais relativement assurées d’assouvir les besoins de pied de pyramide et pour qui la recherche d’émancipation et de réalisation par le travail prend une nouvelle tournure.
De plus en plus, les générations (dont je fais partie) vont remettre en question — au grand dam de leur parents — le dogme de l’emploi sécurisé.
De plus en plus, le but ne va plus être de rentrer dans le schéma de nos parents, à savoir avoir un emploi stable et pérenne, pour ensuite avoir une maison, une voiture, un chien/chat et des enfants.
A partir du début du 21 siècle, les jeunes générations vont se marier de plus en plus tard, voire choisir de ne pas se marier, ou d’autres formes de partenariats de vie, avoir moins d’enfants et se détacher des biens matériels qui caractérisent la génération de nos parents.
III) Que nous réserve l’avenir
Parlons ici rapidement des maux au travail nouvellement définis, tels que le Bore-Out (definition) ou le Brown-Out (definition), qui qualifient la vacuité et l’ennui extrême au travail et pouvant mener à des formes de dépression qui s’ancrent sur l’absence de sens et d’utilité du travail.
Nous voyons fleurir dans les médias les récits de personnes ayant arrêté la vie de bureau pour retourner à un métier qui aurait davantage de sens. Force est de constater que les métiers qui ont du sens sont souvent ceux que permettent de subvenir aux premiers étages de la Pyramide (le soin, la production de nourriture, les métiers manuels, de construction etc), les mêmes que nous avions décidé d’abandonner lors de la première vague de bouleversement du modèle, autour de mai 68.
Les étages les plus élevés de la Pyramide rejoignent de plus en plus sa base primaire : nos besoins d’estime et d’accomplissement sont assouvis lorsque l’on parvient à réorienter notre vie et nos occupations vers les tâches qui jadis, étaient jugées aliénantes voire déshumanisantes. Prenons l’exemple de l’explosion du phénomène des fermes urbaines, qui se développent un peu partout en France (https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-boom-de-lagriculture-urbaine) ! Quête de sens ? Retour à la base ? Boboïsation ? Phénomène éphémère ou retour durable à la terre ?
Je fais le pari que plus nous progresserons dans les décennies à venir, plus nous verrons des crises de la trentaine, quarantaine et voir même de la cinquantaine aboutir à des reconversions vers des métiers et des artisanats qui avaient perdu de leur splendeur au détriment de tous ces métiers qui, aujourd’hui, ne nous font déjà plus rêver.
IV) Conclusion
La crise de la COVID à fini de mettre en exergue la catégorie jusqu’alors floue des métiers que l’on devrait objectivement considérer comme “utiles” à nos sociétés. Force est de constater que ce ne sont pas les emplois du “prestige” qui étaient à la fête. Cette pandémie a été un véritable choc : eh non… Nos diplômes prestigieux, nos outils complexes et nos fichiers excels qui faisaient hier — on le croyait ! — tourner le monde (notre monde) ne sont pas le tissu qui maintenait la société debout (et j’en sais quelque chose, travaillant moi-même dans le secteur financier et n’ayant jamais eu un job manuel).
Pardonnez ce poncif mais ce ne sont pas les responsables marketing, le management, nos auditeurs ou encore les chiefs happiness officers que l’on a applaudis à nos fenêtres. Ce ne sont pas les CTO, CFO, COO, CPO, CMO, PO… qui ont alimenté nos supermarchés.
Je pense que, parmi les effets aujourd’hui sous-étudiés de cette crise planétaire (sanitaire, financière, économique et sociale) va émerger un mouvement massif de réorientation ou d’orientation de nos jeunes générations vers ces métiers que l’on sait aujourd’hui apporter plus de “sens”, pour soi comme pour la société.
La question qu’il faut maintenant se poser est de savoir si le regain d’intérêt que vont connaître ces métiers entraînera une revalorisation pécuniaire ainsi que durable de l’estime qu’on leur porte.